Desiderata, désirées data. Voici un jeu de mots qui exprime la ligne éditoriale de ce blog sur les aspects techniques et patrimoniaux des archives — et en particulier des données1. En guise d’ouverture, je propose donc d’étayer quelques problématiques insignes soulevées par cette quasi-contrepèterie (quasi, car la grivoiserie lui fait défaut).
Les « désidératas » ce sont les choses souhaitées. Le jeu de mot « désirées data » (data signifiant étymologiquement « choses données ») n’en renverse pas, a priori, tout à fait le sens. Aux choses données, on en qualifie le contenu : elles sont ou peuvent être désirées. D’un côté, donc, on a les choses souhaitées; de l’autre, les choses données souhaitées.
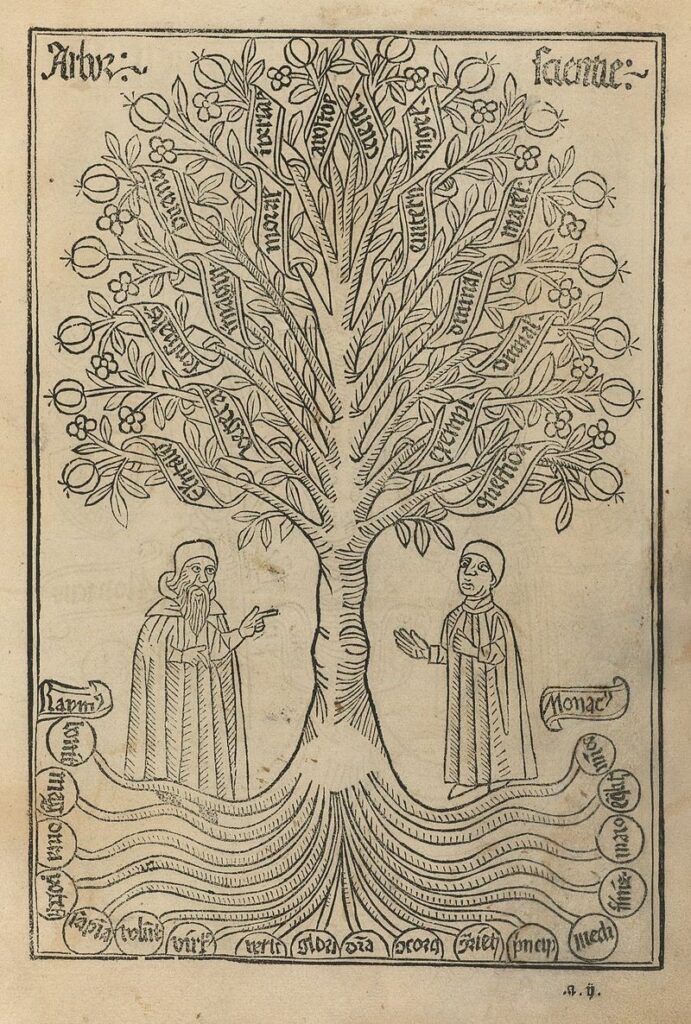
Abandonnons un instant l’étymologie. De façon plus prosaïque, dans le sens commun, les « data », ce sont les données codées et enregistrées dans des systèmes d’information. On peut imaginer que les « désirées data » ce sont donc tout simplement des informations produites et/ou enregistrées pour une volonté particulière . Quelque chose, cependant, me semble plus intéressant.
Les « désirées data » peuvent connoter des enjeux politiques et juridiques liées aux données — sinon des « obtenues »2. D’abord, on peut voir que le participe passé de « données » ou d’ « obtenues » métonymise un processus sous-jacent : les données impliquent aussi les processus de production, d’enregistrement ou de traitement — bref ce à la suite de quoi et par quoi elles existent. Quand on parle de données, on parle des informations (par exemple nous concernant) qui sont capturées, traitées, voire vendues — la loi RGPD en 2016/2018 permet alors de mettre le holà sur l’économie sinon le trafic de nos obtenues. On ne peut pas parler ici de don, de désir, de consentement.

En revanche, parler de data désirées (donc de données et de ses processus qu’elles appellent) renvoie à la sphère du consentement, au don, l’approbation ou à la production et la réception contrôlée de ces informations par des moyens techniques. (Je passe aujourd’hui sur la question de l’arbitraire du choix et de ses déterminations sociales et techniques.)
Et en effet, sur un autre plan — plus proche des domaines scientifique, technique — « désirées data » connote l’idée de « bonnes données ». Car les données désirées peuvent être celles issues de traitements technique et intellectuels en vue d’accomplir une ambition particulière. Cela peut renvoyer par exemple à la Science Ouverte3 et les enjeux de partage et de normalisation de données exploitables; mais aussi aux systèmes d’archivage électronique dont l’efficience et la lisibilité se constituent avec des métadonnées (qui qualifient des données). Une donnée qualifiée, qui n’est donc plus de l’information brute, a fait l’objet d’une attention particulière. Elle a été transformée, « habillée », incluse au sein d’un système d’information; et non pas ignorée ou exclue du champ d’une intention. En ce sens on pourrait dire qu’elle a été désirée, même si c’est à titre de moyen pour une fin (par exemple pour générer des documents numérique).

Je trouve ce petit jeu de mot, sans avoir ici aucune sorte de prétention philosophique, assez fertile. On pourrait sans doute trouver, à la volée, d’autres choses à dire, avancer de nouveaux réseaux de signification. Ou bien justement regretter la superficialité de la métaphore. Gardez en tête, donc, que ce petit texte, comme les patineurs d’eau, glisse sur la surface d’une image. Mais il illustre les questions que j’aborderai sur ce site. Mais comme il est aussi gênant de raconter ses rêves que ses traits d’esprit, j’arrête là les explications et annonce joyeusement l’ouverture du blog !
- On ne répétera jamais assez le Code du Patrimoine, livre 2, et sa modification en 2016 qui ajoute les données dans les définitions des archives. ↩︎
- En reprenant Bruno Latour dans ses Petites leçons de sociologie des sciences. La Découverte, 2007 ↩︎
- Voir par exemple : https://www.ouvrirlascience.fr/initiez-vous-a-la-science-ouverte/ ↩︎
Laisser un commentaire